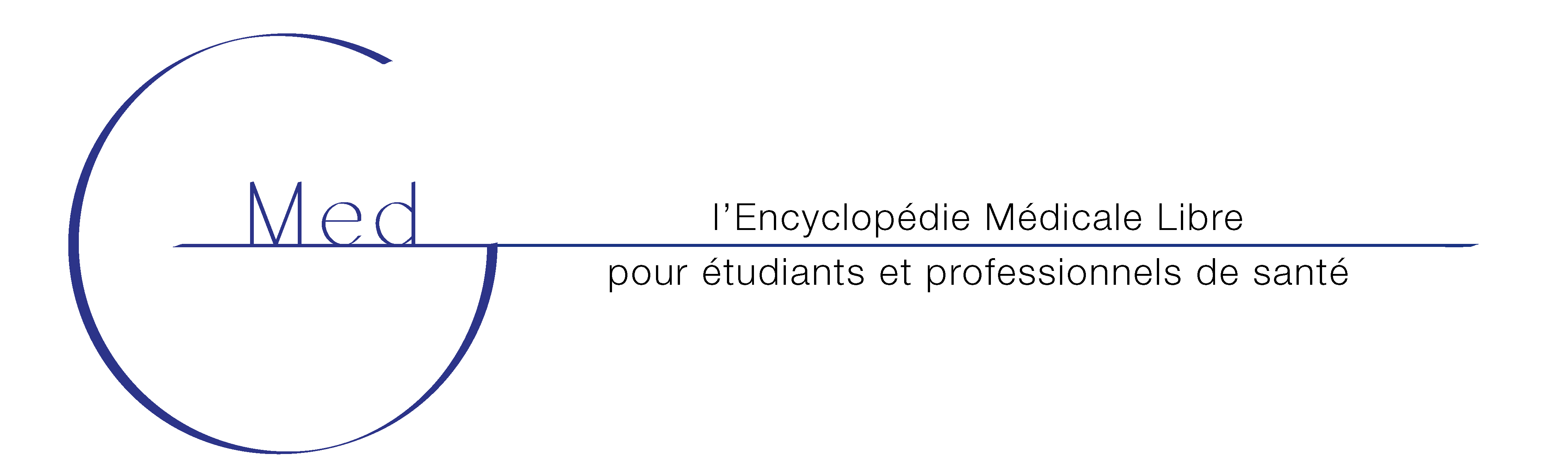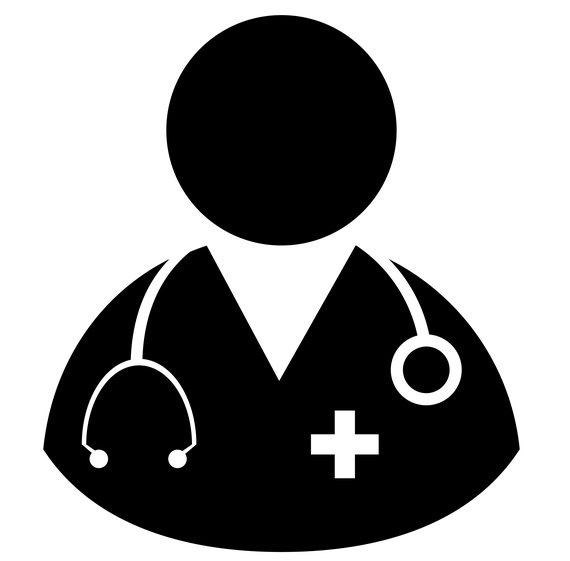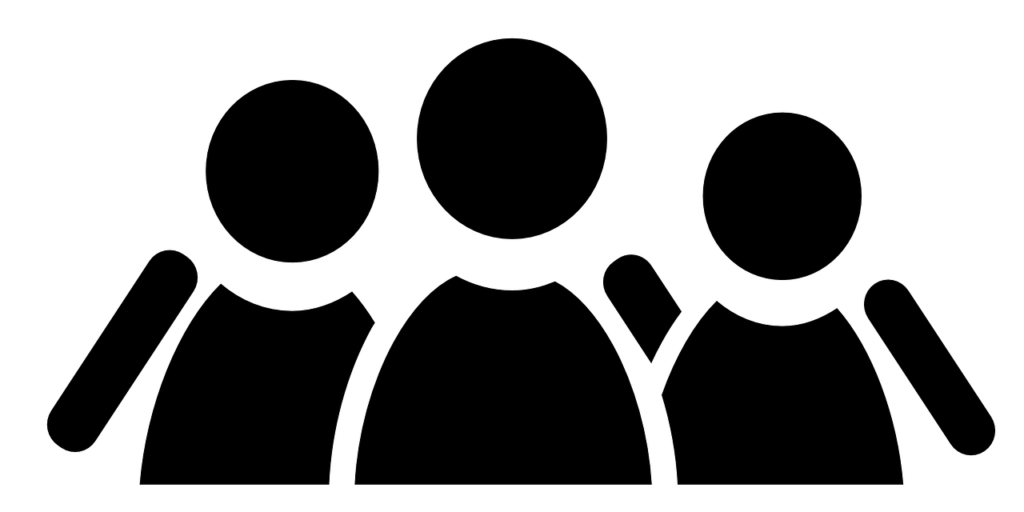1) Généralité 1
Déf : la LMC est un syndrome myéloprolifératif (SMP) caractérisé par l’existence constante dans les cellules souches hématopoïétoiques (CSH) d’une translocation t(9;22) et/ou son équivalent moléculaire, le gène de fusion BCR-ABL. Elle est liée à une atteinte préférentielle de la lignée granuleuse neutrophile, aboutissant à une hyperlymphocytose à polynucléaires neutrophiles avec myelemie.
Epidémio :
– prédomine chez les adultes de plus de 60 ans avec un âge médian de 67 ans, cas pédiatriques très rares
– légère prédominance masculine
Physiopathologie : le gène ABL, situé sur le chromosome 9, code pour une tyrosine kinase dont l’activité devient permanente en cas de fusion BCR-ABL. C’est ce qui se produit dans le cadre d’une translocation t(9;22), le K9 est rallongé et le K22, raccourci (dit ‘chromosome de Philadelphie’), porte les 2 gènes accolés.
La protéine de fusion induit une prolifération excessive de la lignée granuleuse, une diminution de l’apoptose et une perte de l’adhérence cellulaire (à l’origine d’une hyperleucocytose et d’une myélémie).
Etiologies :
-inconnu ++
-exposition chronique au benzène ou aux radiations ionisantes (5% des cas)
2) Diagnostic 1
| Clinique | Paraclinique |
|---|---|
| ± Splénomégalie, AEG, crise de goutte | Hémogramme : hyperleucocytose à PNN et basophiles (+++), myélémie abondante et équilibrée Détection de BCR-ABL sur myélogramme |
A ) Clinique
Facteur de risque : éventuellement exposition chronique au benzène ou aux radiations ionisantes
Circonstances de diagnostic
– Hémogramme systématique (découverte fortuite)
– Bilan de splénomégalie, de douleur abdo (pesanteur HCG), de goutte ou d’hyperuricémie
– Plus rarement, bilan d’asthénie ou d’AEG
Clinique : splénomégalie modérée à volumineuse, le plus souvent isolée
B ) Paraclinique
Hémogramme
– Hyperleucocytose > 50-100 G/L : constituée de PNN, de basophiles, myélémie abondante (passage sanguin de précurseurs / cellules immatures granuleuses) et équilibrée (métamyélocytes et myélocytes > promyélocytes, ± rares blastes circulants)
– Hyperplaquettose généralement modérée, fréquente
– ± Anémie normochrome normocytaire modérée (inconstante)
NB : la basophilie est un signe important devant faire évoquer une LMC même si la leucocytose est modérée !
Notes concernant la biologie
– Il n’y a pas de syndrome inflammatoire
– Il existe des formes cliniques à type d’hyperplaquettose prédominante voire isolée, ou d’hyperleucocytose à PNN sans myélémie , y penser devant une thrombocytémie ‘essentielle’ à marqueurs triple-négatifs
Détection de BCR-ABL +++ : signe le diagnostic avec un hémogramme évocateur !
– Indispensable devant toute suspicion de LMC
– Recherche du transcrit de fusion et/ou de la translocation t(9;22)
– Recherche sanguine possible dans un 1er temps, obligatoirement confirmée par myélogramme
Myélogramme (BOM « en règle pas nécessaire ») : permet de vérifier l’absence d’excès de blastes (phase chronique) et la réalisation d’un examen cytogénétique complet, à la recherche d’anomalies complexes ou additionnelles
C ) Diagnostic différentiel
La question du différentiel ne se pose qu’avant la recherche de BCR-ABL.
Hyperleucocytose modérée avec ou sans myélémie : causes inflammatoires, infectieuses et iatrogènes
Hyperplaquettose prédominante : thrombocytoses réactionnelles et thrombocytémie essentielle
Hyperleucocytose avec myélémie déséquilibrée (prédominance de blastes ± érythromyélémie, BCR-ABL négatif) : myélofibrose primitive, SMP atypique
Autres causes de splénomégalie
3) Evolution 1
A) Histoire naturelle
> Evolution en 3 phases ( 5-10 % des diagnostics en phase 2 ou 3)
– Phase chronique : dure en moyenne 5 ans
– Phase d’accélération (inconstante) : dure 12-18 mois avec amaigrissement, fièvre, douleurs osseuses, sueurs nocturnes, splénomégalie, évolution de l’hémogramme (basophilie, apparition de blastes, thrombopénie < 100 G/L)
– Phase de transformation aiguë : évolution en leucémie aiguë myéloblastique (2/3) ou lymphoblastique B (1/3)
Guérison complète possible sous traitement.
Facteur pronostique : diagnostic en phase d’accélération ou de transformation aiguë
B) Complications
– Communes aux SMP : thromboses artérielles et veineuses, évolution en leucémie aiguë
– Crise de goutte liée à l’hyperuricémie, fréquent au diagnostic
4) PEC 1
A ) Bilan
Bilan des complications : uricémie, fonctions hépatique et rénale, LDH
B ) Traitement
-
Traitement anti-cancéreux
> Inhibiteurs de BCR-ABL (inhibiteurs de la tyrosine kinase – ITK- d’action ciblée sur ABL)
Imatinib : 400 mg/j PO, largement utilisé en 1ère ligne
ITK de 2e génération – Dasatinib, nilotinib, bolutimib : plus puissants et spécifiques, mais plus d’effets indésirables graves
ITK de 3e génération – Ponatinib : dernière intention
Ces traitements ont totalement supplanté les myélosuppresseurs utilisés jusqu’aux années 2000. Ils permettent d’espérer une guérison complète (arrêt sans rechute chez des patients en très bonne réponse, à confirmer à plus long terme). Ils nécessitent une observante parfaite, obligatoire pour l’obtention d’une bonne réponse clinique et biologique.
> Allogreffe de cellules souches ou de moelle osseuse
Presque plus utilisée depuis l’avènement des ITK, l’allogreffe garde quelques indications en cas de transformation aiguë, de résistance aux médicaments ciblés ou chez les enfants.
C) Suivi
Les protocoles associent
– Examen clinique avec palpation splénique
– Hémogramme : décroissance des leucocytes, myélocytes et autres anomalies
– Caryotype sur moelle tous les 6 mois jusqu’à ce que la t(9;22) soit indétectable
– Surveillance sanguine du transcrit BCR-ABL : trimestriel puis semestriel, poursuivi à vie, même lorsque le taux devient indétectable